Parce qu’il est urgent de reprendre le contrôle sur les infrastructures du numérique, plusieurs communautés s’organisent déjà pour résister. Un collectif de responsables d’associations, de syndicats et de militants demande un moratoire sur la construction de nouveaux "datacenters" ainsi que la mise en place de débats publics.
Du 8 au 11 avril, l’Assemblée nationale débat du projet de loi de simplification de la vie économique (PLS). On y trouve de nombreuses mesures dérogatoires au droit commun, une perte de pouvoir de la Commission nationale du débat public, un retour en arrière sur la loi Zéro artificialisation nette, sur la protection des espèces menacées, une perte des compétences des collectivités territoriales. Il s’agit d’un démantèlement lent mais assuré des maigres législations écologiques et démocratiques qui encadraient encore les élans du capitalisme technologique.
Le PLS concerne aussi la facilitation des installations industrielles notamment minières, prétendument de transition énergétique et paradoxalement associées aux infrastructures du numérique, comme les data centers, dont il s’agirait de faciliter l’installation en France pour une supposée souveraineté numérique.
Les infrastructures du numérique, qui permettent à l’information numérique de circuler et aux services du cloud d’apparaître sur nos écrans, sont organisées en data centers interconnectés par les câbles de fibres optiques sous-marins. Et pour faire des data centers, des câbles et les usines de production énergétique pour les alimenter, il faut des mines, d’où sont extraits les minerais qui composeront les puces des serveurs et des cartes graphiques, nécessaires au fonctionnement desdites intelligences artificielles.
Le cloud était sous nos pieds : le déploiement des infrastructures du numérique est soutenu par une relance débridée de l’extractivisme et des prédations qui y sont liées. Elles sont les nouvelles infrastructures de la domination impérialiste : il faut en être pour continuer à faire partie des grandes puissances mondiales, quitte à ouvrir grand les portes à tous ces investisseurs privés pour faire de la France une «data center nation». Alors que les dépendances technologiques envers les multinationales étasuniennes alignées derrière le programme d’extrême droite de Donald Trump sont croissantes, le temps ne peut pas être à la dérégulation.
Rester dans la course de l’IA
Le projet de loi Simplification propose de conférer aux data centers le statut de projet d’intérêt national majeur. Par là, il faut entendre le statut de raison impérative pour rester dans la course à l’IA. Tant pis si vous devez attendre dix ans de plus l’électrification d’activités polluantes ; tant pis si les massacres en République démocratique du Congo redoublent d’intensité ; tant pis pour les terres que les paysannes abandonnent, faute d’eau disponible, tant pis si on ne sait toujours pas réemployer les puces et si les décharges de déchets du numérique s’étendent à perte de vue ; tant pis si les data centers dans lesquels on stocke les données de l’Etat sont soumis aux lois états-uniennes ; tant pis si la vitalité des quartiers populaires est sacrifiée aux chaleurs produites des réfrigérateurs géants. Il n’y a pas de négociations à avoir. Au contraire, le gouvernement propose de graver dans la loi une fiscalité allégée et un accès prioritaire au réseau électrique public. Le numérique dominant s’impose, rendant obsolète nos machines, nos compétences et parfois même nos corps.
Nous pensons que le moment est venu de reprendre le contrôle collectivement sur les infrastructures du numérique. La souveraineté numérique, ça ne peut pas être de tenter désespérément d’arracher un segment d’une chaîne de valeur contrôlée par des multinationales étrangères en les attirant sur le territoire français avec une législation et une fiscalité aguicheuse.
D’autres manières d’hériter de ce monde abîmé
Partout sur le territoire et à l’étranger, de nombreuses communautés s’organisent déjà pour résister à ce numérique dominant : collectifs en lutte contre les projets miniers, contre les fonderies de puces microélectroniques dédiées à l’armement et aux gourdes connectées, contre les implantations de data centers s’appropriant l’eau des rivières ou l’eau potable, ou les importations croissantes des minerais de sang ; riverain·e·s qui suffoquent déjà trop de la toxicité de ce monde industriel, qui voient des projets d’intérêt général rendus impossibles par la saturation des réseaux d’électricité ou qui cherchent à privilégier des lieux de vie où on privilégie l’humain ; comme les chercheur·euse·s qui documentent les impacts écologiques du numérique, les déchets produits, qui étudient la déchéance des utopies d’Internet ou encore les dimensions géopolitiques croissantes ; comme les artistes et designers qui cherchent à fabriquer d’autres récits et d’autres manières d’hériter de ce monde abîmé, ou qui inventent des réseaux sociaux qui tiennent avec un téléphone portable pour serveurs ; comme les communautés de logiciels libres et leshackerspacesqui fabriquent des serveurs low tech.
A l’opposé de cette loi, nous demandons collectivement un moratoire sur la construction de nouveaux data centers et la mise en place de débats publics, qui pourraient prendre la forme de conventions citoyennes, ainsi qu’un soutien aux projets de recherches actions ayant pour objectif de mettre au travail des alternatives réelles et de célébrer la joie qui circule quand on parvient à penser ensemble.
Contre la fuite en avant, ralentissons et osons faire monde commun.
Signataires :
Adrien Montagut, codirigeant de la coopérative Commown en charge des affaires publiques
Anne Stambach-Terrenoir, députée la France insoumise de Haute-Vienne
Annick Ordille, membre du collectif Le Nuage était sous nos pieds
Arnaud Bonnet, député du Groupe Écologiste et Social
Aurora Gómez Delgado, porte-parole du collectif TuNubeSecaMiRío
Baptiste Hicse, membre du collectif StopMicro
Camille Etienne, autrice et militante écologiste
Catherine Hervieu, députée du Groupe Écologiste et Social
Charles Fournier, député du Groupe Écologiste et Social
Claire Lejeune, députée la France insoumise de l’Essonne
Clément Marquet, chargé de recherche en sciences techniques et société, Mines Paris – PSL,
Cy Lecerf-Maulpoix, auteur et chercheur
Cyrielle Chatelain, députée du Groupe Écologiste et Social
David Cormand, député européen écologiste
David Maenda Kithoko, Président de Génération Lumière
Denis Nicolier, membre de Halte au controle numérique
Dominique Voynet, députée du Groupe Écologiste et Social
Doriane Timmermans, Artiste-Developpeuse-Designeuse-Enseignante travaillant avec et au cœur des technologies
Eva Sas, députée du Groupe Écologiste et Social
Jeanne Guien, chercheuse
Jérôme Moly, président de l’association GreenIt
Julie Ferrua, co-déléguée générale de l’Union syndicale Solidaires
Julie Ozenne, députée du Groupe Écologiste et Social
Julien Lefevre, membre de Scientifiques En Rebellion
Laurence Allard, enseignante-chercheuse, Labo Citoyen
Léa Balage, députée du Groupe Écologiste et Social
Lisa Belluco, députée du Groupe Écologiste et Social
Lou Chesné, porte-parole Attac France
Lou Welgryn et Théo Alves Da Costa, secrétaire générale et Président de Data for Good
Loup Cellard, chercheur dans la coopérative Datactivist et membre associé du médialab de Sciences-Po Paris
Manon Meunier, députée la France insoumise de Haute-Vienne
Manuel Bompard, député la France insoumise des Bouches-du-Rhone
Ophélie Coelho, chercheuse associée à l’Institut de Relations internationales et stratégiques (IRIS), Centre Internet et Société, auteure
Raquel Radaut, porte parole de La Quadrature du Net
Sandra Regol, députée du Groupe Écologiste et Social
Sandrine Nosbé, députée la France insoumise de l’Isère
Sébastien Barles, adjoint au Maire de Marseille, en charge de la transition écologique
Steevy Gustave, député du Groupe Écologiste et Social
Stéphane Coppey, Administrateur FF délégué au juridique France Nature Environnement
Stéphen Kerckhove, directeur général d’Agir pour l’environnement
Thomas Thibault, vice-président du Mouton Numérique
Vidéo réalisée par La Quadrature du Net, et Le nuage était sous vos pieds
Appelez vos député·es (voir article LQDN en lien)
Pour qu'ils soutiennent l'amendement n° 834 de suppression de l’article 15.
Argumentaire pour un moratoire sur les gros data centers
Voici quelques données à avoir en tête pour convaincre les député·es de rejeter l’article 15 et d’adopter un moratoire sur les gros data centers !
1. Les data centers engendrent une intense prédation des ressources en eau et en électricité
- Les data centers sont particulièrement électro-intensifs : selon RTE, il y a 300 data centers en France (en 2022). Leur consommation est estimée à environ 10 TWh, soit autour de 2% de la consommation française totale annuelle. Les projets se multiplient et il n’est pas rare selon RTE de recevoir des demandes de raccordement à hauteur de 100 à 200 MWh, soit une fourchette équivalente aux consommations électriques des villes de Rouen et Bordeaux.
- On assiste aujourd’hui à un boom spéculatif autour de l’IA et des data centers : en France, le bilan prévisionnel de RTE prévoit un triplement de la consommation d’électricité des data centers d’ici à 2035, elle pourrait atteindre 4% de la consommation nationale. Plus de 4,5 GW de demandes de raccordement de data centers ont déjà été signées et le même volume est en cours d’instruction. Plusieurs data centers d’une puissance maximale de 1 GW, soit l’équivalent d’un réacteur nucléaire, ont été annoncés en février 2025 lors du sommet sur l’IA.
- Les data centers nécessitent la création (et donc le financement public) de nouvelles sources de production énergétique, comme en attestent les réouvertures de centrales nucléaires ou fossiles dédiées un peu partout dans le monde et de nouveaux réseaux saturés par leurs consommations.
- En ce qui concerne l’eau utilisée en masse pour refroidir les serveurs, Google a par exemple révélé avoir prélevé dans le monde 28 milliards de litres d’eau en 2023, dont les deux tiers d’eau potable, pour refroidir ses data centers. La même année, Microsoft rapporte une augmentation de 34% de sa consommation d’eau annuelle pour ce même usage. À Marseille, Digital Realty s’accapare de l‘eau « qualité potable » pour refroidir ses installations, avec le soutien financier de l’ADEME.
→ Des instances de maîtrise démocratique de l’impact écologique et foncier de l’industrie de la tech doivent d’urgence être établies pour lutter contre ces prédations croisées sur l’eau et l’électricité, et assurer une trajectoire de sobriété.
2. Accompagnant la prolifération de l’IA, les data centers sont l’objet d’un déploiement territorial incontrôlable
- Depuis une dizaine d’années, les centres de données (aujourd’hui au nombre de 300 environ à l’échelle française) se multiplient en France. La proportion des grands data centers (+ de 2 000m2) se concentre notamment en Ile-de-France (160 sites) et à Marseille (12 sites).
- Les industriels profitent de manquements et d’imprécisions juridiques sur leurs statuts, et les data centers peuvent ainsi être qualifiés d’entrepôts ou de local industriel. Le Code Général des impôts n’en propose aucune définition légale, leur fiscalité reste floue, et les industriels du data center comme Orange jouent avec l’optimisation fiscale. De ce fait, de nombreuses techniques de contournements du peu de législations existantes sont ainsi documentées, notamment autour des techniques dites de phasage ou de saucissonnage, c’est-à-dire la construction de plusieurs data centers interconnectés sur un même site ou l’augmentation progressive de capacité. Ces tactiques permettent aux data centers de rester sous les seuils de contrôle notamment ICPE, comme on l’observe à Aubervilliers (Digital Realty), La Courneuve (Digital Realty) ou à Wissous (Cyrus One et Amazon).
- Les industriels des data centers profitent également d’une absence de planification territoriale et urbaine : il n’existe pas de schéma directeur d’implantation, ou d’outil de régulation sur l’expansion territoriale des data centers (source). Ils s’accaparent ainsi d’immenses espaces fonciers : l’entreprise étasunienne de data centers Digital Realty possède 17 data centers en France, occupe plus de 111 000 m2 de terrains, sans compter les dizaines de nouvelles implantations en cours, pour seulement 230 employé·es en CDI.
- Les data centers ne génèrent presque aucun emploi. Le ratio est évalué à un Emploi Temps Plein (ETP) pour 10 000 m2 occupés en moyenne. La prolifération des data centers sur le territoire se fait donc au détriment d’autres projets plus alignés avec les besoins des territoires et créateurs d’emplois locaux.
- Le modèle de déploiement des data centers aggrave les inégalités territoriales, avec une concentration et prédation territoriale due à l’effet « magnet » (« aimant ») : les data centers fonctionnent en « hub » et ne sont jamais isolés.
→ Il est nécessaire de mettre ce déploiement en pause, de construire une stratégie concertée sur des infrastructures du numériques qui répondent aux besoins de la société et non aux intérêts économiques de la tech et des fonds d’investissements qui la soutiennent.
3. Les data centers se multiplient dans une opacité systémique, sans prise en compte des alternatives
- Les data center sont des infrastructures complexes, en constante évolution. Il en résulte une grande méconnaissance des pouvoirs publics et de la population, et donc une réelle difficulté à répondre aux argumentaires volontairement techniques et au greenwashing avancés par les industriels pour défendre le bien-fondé de leurs projets.
- Nous sommes confrontés à une absence totale de transparence, de données et de mesures partagées par les industriels sur leurs consommations (en eau ou électricité notamment), sur les impacts et coûts réels des data centers. Souvent, le débat est tronqué par des mensonges par omissions et autres manipulations. Ainsi, selon le Guardian, les émissions de gaz à effet de serre des centres de données de Google, Microsoft, Meta et Apple sont environ 662% plus élevées que les déclarations officielles.
- La Directive européenne sur l’Efficacité Énergétique (DEE) de 2022 rend obligatoire pour tous les data centers de plus de 500 kWh la publication d’un ensemble de données sur leurs consommations. Or, actuellement, en mars 2025, ces données ne sont toujours pas disponibles.
- Les alternatives au modèle dominant dans la construction des data centers sont aujourd’hui très mal connues et documentées, laissant supposer que des data centers de plus en plus gros sont absolument nécessaires au bon fonctionnement d’Internet et des services numériques. Or, de nombreux collectifs, associations, organisations, proposent des alternatives locales, low tech et décentralisées, qui ne reposent pas sur des besoins de stockages de données à grande échelle.
→ Face à l’opacité systémique, il nous faut produire une connaissance précise qui prenne en compte les enjeux sociaux, écologiques et géopolitiques des infrastructures du numériques aussi bien que les alternatives aux technologies dominantes.
4. Les data centers sont des infrastructures sensibles à la dangerosité mal évaluée
- Les data center sont des bâtiments dangereux et présentant de nombreux risques pour les habitant·es et les territoires. Cuves de fioul ou de gaz perfluorés susceptibles de fuiter, stockage important de batteries au lithium qui peuvent générer d’immenses incendies (comme celui de Strasbourg), grande vulnérabilité à la chaleur. Bien loin de l’image du simple entrepôt inerte, un data center est bien une usine de production industrielle dédiée au stockage de données et aux calculs informatiques.
- Ils génèrent de nombreuses pollutions (accidentelles ou fonctionnelles), notamment atmosphériques, ainsi que des nombreuses nuisances ainsi qu’une quantité importante de ainsi que des nombreuses nuisances ainsi qu’une quantité importante de déchets non recyclables et une production de chaleur très importante qui augmente les risques de canicule ou de réchauffement non mesurés des milieux adjacents.
- Selon l’ADEME, le numérique est à l’origine de 4,4 % de l’empreinte carbone en France en 2024, en nette augmentation (2,5% en 2020). Entre 2016 et 2024, l’empreinte carbone des data centers dans l’impact global du numérique est passée de 16% à 46%.
→ Les data centers sont des infrastructures dangereuses, et il est nécessaire de protéger les habitant.e.s et les écosystèmes des pollutions et des nuisances qu’ils engendrent.
5. Les data centers s’accompagnent d’impacts sociétaux nombreux et insoutenables
- Les data centers encouragent l’extractivisme minier, les nombreux conflits qui y sont liés et les crimes contre l’humanité documentés dans de nombreux contextes miniers, comme en République démocratique du Congo.
- Ils présentent en outre des risques structurels pour l’économie française, tel le déploiement massif des IA et des processus d’automatisation dans tous les pans de la société.
- Le gouvernement prétend assurer la souveraineté nationale mais accroît en fait notre dépendance technologique aux GAFAM, comme l’illustre le rôle majeur d’entreprises étasuniennes telles Amazon, Microsoft ou Digital Realty ainsi que des fonds d’investissements extra-européens dans le boom actuel de ces infrastructures. Compte tenu de la structure actuelle de l’économie numérique, la « territorialité de la donnée » est une illusion.
- Parce que la France se targue d’une énergie nucléaire qui permet de faire baisser les « bilans carbone » des multinationales de la tech, et parce qu’elle est idéalement placée sur la carte internationale des câbles sous-marins, elle est vue comme un territoire de choix, faisant de nos territoires une ressource vendue plus offrants dans un marché en surchauffe.
→ Il faut reprendre la main sur les infrastructures du numériques et le monde qu’elles génèrent. Il ne s’agit jamais d’enjeux simplement techniques : derrière les data centers, de nombreux enjeux politiques doivent être soulevés et débattus.
Articles précisant la demande d'un moratoire
Loi "Simplification" : Stop au boom des data centers ! (04/2025)
Interview de GreenIt, La Quadrature du Net et du collectif Le nuage était sous nos pieds (04/2025)
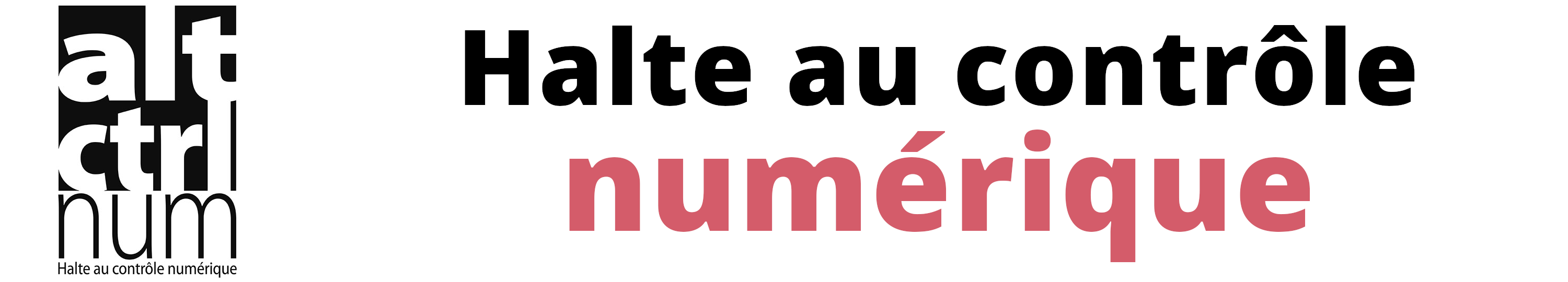

2 réponses sur « Tribune HIATUS dans Libération : Contre la "loi simplification", ralentissons et osons faire front commun »
[…] coeur d’une discrète bataille parlementaire, remportée par les partisan-es de l’IA. Dans le projet de loi dit "de simplification de la vie économique" du gouvernement, visant à déréguler nombre d’activités, l’article 15 dédié aux projets de […]
[…] Tribune HIATUS dans Libération : Contre la "loi simplification", ralentissons et osons faire front … (04/2025) […]