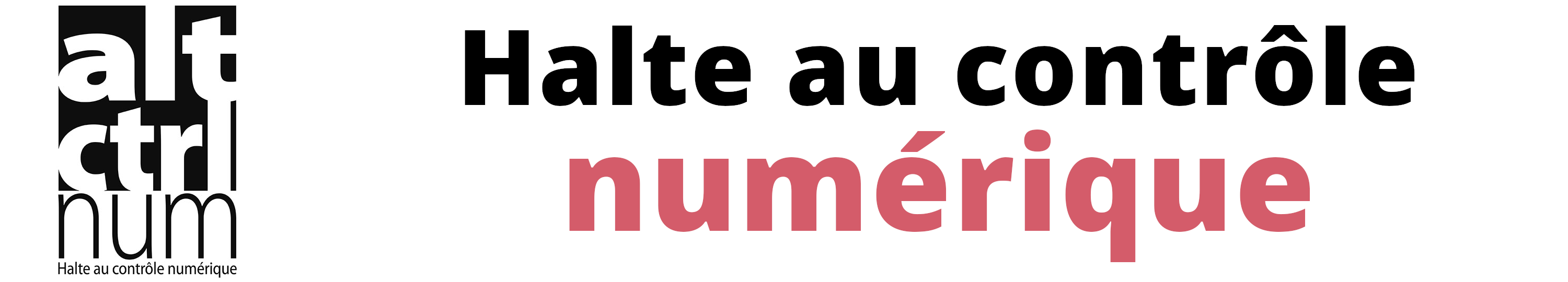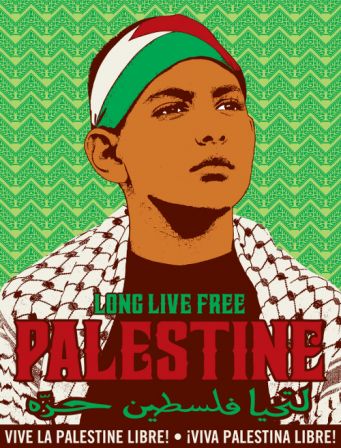À l’heure où l’Union européenne vient d’être "mise en demeure pour manquement à son obligation d’agir face au risque avéré de génocide à Gaza", un large ensemble d'enseignant·es et chercheur·es, français·es et japonais·es, appelle à des décisions fortes du gouvernement français. "Quel niveau supérieur de ravage devra-t-on atteindre pour que la France emboîte le pas des pays ayant rejoint l’Afrique du Sud, dans sa saisine,de la Cour internationale de Justice ?"
"La guerre de Gaza restera dans l'histoire comme l'un des exemples les plus horribles et les plus troublants de mort et de destruction massives facilitées par la technologie. Nous ne devons pas permettre que Gaza devienne le modèle d'une future guerre numérique".
Marwa Fatafta, Access Now
Une communauté : c’est ce qu’ont formé, en l’espace de quelques jours, dans un pays réputé peu enclin aux prises de position publiques, de nombreux.ses intellectue.le.s japonais.e.s francophones atterré.e.s par la situation à Gaza, autour de cette tribune et aux côtés de leurs collègues français.es, avec lesquel.le.s ils partagent non seulement le quotidien universitaire mais aussi les valeurs historiquement attachées à la France : respect du droit international, liberté d’expression et liberté d’informer, exigence de justice, défense des opprimés... Toutes et tous, profondément inquiets, voulons rester confiants et appelons à des décisions fortes du gouvernement français.
À l’heure où l’Union européenne vient d’être « “mise en demeure” pour “manquement” à son “obligation d’agir face au risque avéré de génocide à Gaza” » (Le Monde, 18 mai 2025), nous, enseignant.e.s et chercheur.e.s, français.e.s et japonais.e.s, spécialistes des cultures et sociétés francophones, dans le souvenir encore vif de la douleur et de l’atterrement ressentis lors du massacre terroriste perpétré par le Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, sur des hommes, des femmes et des enfants, dénonçons tout aussi fermement la politique agressive, sans mesure aucune, guidée par l’esprit de vengeance et d’annexion plutôt que par une nécessité strictement défensive, et contraire en tous points aux conventions du droit international, engagée par le gouvernement suprémaciste de Benjamin Netanyahou.
Depuis longtemps alarmés par le ciblage des populations civiles de Gaza, la décimation de familles entières, le nombre effarant d’enfants tués, blessés, mutilés, traumatisés à vie (50 000 selon l’UNESCO, mai 2025), par l’ampleur enfin des destructions matérielles dont le monde entier a reçu, en dépit d’un implacable blocus médiatique et d’une exceptionnelle hécatombe parmi les journalistes locaux, des images accablantes, nous avons compris que cette réplique militaire dépassait de très loin l’objectif initial d’éradication du terrorisme et de libération des otages israéliens, par lequel s’est incessamment justifié et se justifie encore le premier ministre.
Elle s’avance désormais, et de manière de plus en plus désinhibée dans les déclarations publiques des autorités en place, avec les armes de la famine, du déplacement forcé, voire de la déportation de masse, avec l’arsenal de brutalité inhérent aux conquêtes territoriales, comme une entreprise de destruction systématique d’un peuple, qui n’a plus rien à voir avec le droit d’un État à protéger son intégrité.
Quel niveau supérieur de ravage devra-t-on atteindre pour que la France, qui officiellement affirme vouloir "se mobiliser pour la mise en œuvre de la solution à deux États" (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères), et à sa suite les nombreux autres soutiens d’une guerre présentée par Benjamin Netanyahou comme de "légitime défense" (Le Monde, 29 avril 2024), emboîte le pas des quinze pays ayant à ce jour rejoint l’Afrique du Sud, dans sa saisine, dès décembre 2023, de la Cour internationale de Justice ?
Les Nations Unies le rappellent, par la voix du Centre régional d’information pour l’Europe occidentale : "Pretoria accuse Israël de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans son assaut militaire à Gaza" (6 mars 2025).
L’enjeu majeur était donc d’anticiper. Il s’est agi pour le Nicaragua, et successivement pour la Belgique, la Colombie, la Libye, l’Égypte, le Mexique, la Palestine, l’Espagne, la Turquie, le Chili, les Maldives, la Bolivie, l’Irlande, Cuba et Bélize, d’initier un mécanisme juridique d’alerte afin de stopper un processus embryonnaire — plus clairement dit : afin d’éviter la réalisation d’un génocide. Le gouvernement Netanyahou a dès lors été invité à prendre des mesures provisoires.
Non seulement il n’en a rien fait, mais encouragé par les projets d’accaparement du président Donald Trump, il multiplie les dévastations : bombardements meurtriers continus, liquidation des infrastructures de santé, attaques contre les travailleurs humanitaires (408 morts, ONU, avril 2025), concentration des populations gazaouies affamées, privatisation et militarisation de l’aide, arasement total des zones pilonnées.
Quelle nouvelle preuve d’anéantissement faudra-t-il donc aux États pour qu’ils appliquent la lettre et l’esprit de cette Convention, dont on se doit de rappeler ici qu’elle fut signée, entre autres, par Israël, les États-Unis et la France, dans la sidération de l’après-guerre, puis ratifiée par eux, leur imposant par conséquent une obligation tant morale que juridique ?
Il nous paraît irresponsable, et pour tout dire logiquement aberrant, de vouloir s’en remettre aux "historiens, en temps voulu" (Emmanuel Macron, 13 mai 2025), pour caractériser après coup — au mieux donc : pour rien, et au pire : trop tard —, un crime de masse que le recours immédiat et sans réserve au droit, assorti de la reconnaissance d’un État palestinien, d’un embargo sur les armes et de sanctions adaptées, auraient sans doute le pouvoir d’enrayer.
Toutes mesures auxquelles, dans l’urgence, nous appelons avec vigueur. Il y va des principes d’humanité et de droit que nous nous attachons à illustrer et à faire rayonner par notre enseignement et nos recherches.
Co-auteurs :
Ammour-Mayeur Olivier (International Christian University) ; Bizet François (Université de Tokyo) ; Brosseau Sylvie (Université Waseda) ; Couchot Hervé (Université Sophia) ; Dussud Odile (Université Waseda) ; Ferrier Michaël (Université Chûô).
Signataires :
Agaesse Julien (Université de Tokyo) ; Akiyama Nobuko (Université Aoyama Gakuin) ; Asama Teppei (Université Meiji) ; Avocat Eric (Université d’Osaka) ; Baccaro Sophie (Université Chuo) ; Bélec Cédric (International Christian University) ; Bertrand Cédric (Kanazawa Institute of Technology) ; Bonnin Philippe (CNRS) ; Brancourt Vincent (Université Keio) ; Cajot Kevin (Université Gakushûin) ; Capel Mathieu (Université de Tokyo) ; Carton Martine (Université Waseda) ; Cheddadi Aqil (Université Keio) ; Chijiwa Yasuko (International Christian University) ; Codognet Bianca (Université Waseda) ; Couchot Marina (Université Chuo) ; Date Kiyonobu (Université de Tokyo) ; Delemazure Raoul (Université de Tokyo) ; Delmont-Osaka Marie-France (Université Rikkyo) ; Deniau Philippe (Université de Hitotsubashi) ; Derible Albéric (Université de Tokyo) ; Détrie Muriel (Université Sorbonne Nouvelle) ; De Vos Patrick (Université de Tokyo, émérite) ; Dhorne France (Université Aoyama Gakuin) ; Diot Rodolphe (Université de Hirosaki) ; Fayolle Simon (IFJ Osaka) ; Fayolle-Irie Yoko (Université Konan) ; Fujii Shintaro (Université Waseda); Fukai Akiko (Historienne du costume); Galan Christian (Université Toulouse-Jean Jaurès) ; Giunta Léna (Université Waseda) ; Groisard Jocelyn (Université métropolitaine de Tokyo) ; Hagiwara Yoshiko (Université Meiji) ; Hamano Koichiro (Université Aoyama Gakuin) ; Harder Yves-Jean (Université de Strasbourg) ; Hashimoto Kazumichi (Université Waseda) ; Hatakeyama Naoya (Photographe) ; Hemmi Tatsuo (Université de Niigata) ; Hirata Shu, Université Nanzan ; Hori Chiaki (Université Waseda) ; Hoshino Moriyuki (Université de Tokyo) ; Imaseki Kanako (Université Waseda) ; Imazeki Ann (Université Meiji) ; Inoue Takako (Université Dokkyo) ; Iwano Takuji (Université Meiji) ; Iwasaki Erina (Université Sophia) ; Iwata Mayuko (Université Meiji) ; Izumi Kunihisa (Université Sophia) ; Jolivet Muriel (Université Sophia) ; Kasama Naoko (Université Kokugakuin) ; Katsumata Makoto (Université Meiji Gakuin) ; Kiritani Kei (Université des Beaux-Arts de Kanazawa) ; Kitahara Mariko, Université Waseda ; Koemon Katsuhiko (Université Meiji) ; Koishi Atsuko (Université Keio) ; Kojima Machiko (Université Sophia) ; Konno Takeru (Université Meiji) ; Kunieda Takahiro (Université Keio) ; Kuroki Hidefusa (Université Rikkyo) ; Kuwada Kohei (Université de Tokyo) ; Le Blanc Claudine (Université Sorbonne Nouvelle) ; Lelong Stéphane (Université Sophia) ; Lencquesaing (de) Marion (Université Aoyama Gakuin) ; Li Jinja (INALCO) ; Lozerand Emmanuel (INALCO) ; Lucken Michael (INALCO) ; Masuda Kazuo (Université de Tokyo, émérite) ; Matsui Hiromi (Université de Tokyo) ; Matsuura Hisao (Université des Beaux-Arts Tama); Mehrenberger Maki (Université Sophia); Mevel Yann (Université du Tohoku); Mitsubori Koichiro (Institut des Sciences de Tokyo) ; Miura Nobutaka (Université Chuo, Maison Franco-Japonaise) ; Mizubayashi Michèle (Université Dokkyo) ; Morimoto Yosuke (Université de Tokyo) ; Moussa Sarga (CNRS) ; Murakami Yuji (Université de Kyoto) ; Murakawa Seiji (Université Waseda) ; Muratami Katsunao (Université de Tokyo) ; Nakaji Yoshikazu (Université de Tokyo); Nakajima Makiko (Université Waseda); Nemoto Misako (Université Meiji); Nishiyama Tatsuya, Université Waseda ; Nishiyama Yuji (Université métropolitaine de Tokyo) ; Noike Keiko (Université Waseda) ; Nozaki Kan (The Open University of Japan) ; Ogawa Kimiyo (Université Sophia) ; Ogawa Midori (Université de Tsukuba) ; Okabe Aomi (Université des Beaux-Arts de Musashino) ; Oki Sayaka (Université de Tokyo) ; Omoda Sonoe (Université Meiji) ; Ono Aya (Université Keio) ; Ono Marie-France (Lycée français international de Tokyo) ; Ono Yuriko (Université Chûô) ; Pelissero Christian (IFJ Tokyo) ; Perroncel Morvan (Maison franco-japonaise) ; Quentin Corinne (MFJ- Traductrice) ; Roussel François (Université Daito Bunka) ; Sakai Cécile (Université Paris-Cité, émérite) ; Sakuma Yutaka (Université Meiji) ; Sato Tomoko (Université de Kanazawa) ; Sato Yoshiyuki (Université de Tsukuba) ; Sato Yukio (Université de Toyama, émérite) ; Sato-Robein Christine (Université Waseda) ; Sawada Nao (Université Rikkyo) ; Seo Shuhei (Université Waseda) ; Shiotsuka Shuichiro (Université de Tokyo) ; Sublime Viviane (IFJ Tokyo) ; Sugiura Yuriko (Université Hiroshima Shudo) ; Suzuki Keiji (Université de Tokyo, émérite) ; Suzuki Masao (Université Waseda) ; Taguchi Takumi (Université Chûô) ; Takahashi Akeo (Université Sophia) ; Takakuwa Kazumi (Université Keio) ; Tanaka Hiroki (Université Meiji); Taniguchi Asako (Université Meiji); Tanikawa Kaoru (Université Komazawa) ; Teixeira Vincent (Université de Fukuoka) ; Toriyama Teiji (Université de Tokyo); Tuchais Simon (Université Sophia); Ukai Satoshi (Université Hitotsubashi, émérite) ; Vansintejean Cathy (Université Waseda) ; Watanabe Io (Université Meiji) ; Watanabe Kôji (Université Chûô) ; Watanabe Kyoko (Université Meiji) ; Yamazaki Sylvie (Lycée français international de Tokyo) ; Yokoyama Yoshiji (Université Gakushûin) ; Yoshikawa Kazuyoshi (Université de Kyoto) ; Zegrour Amira (Traductrice)