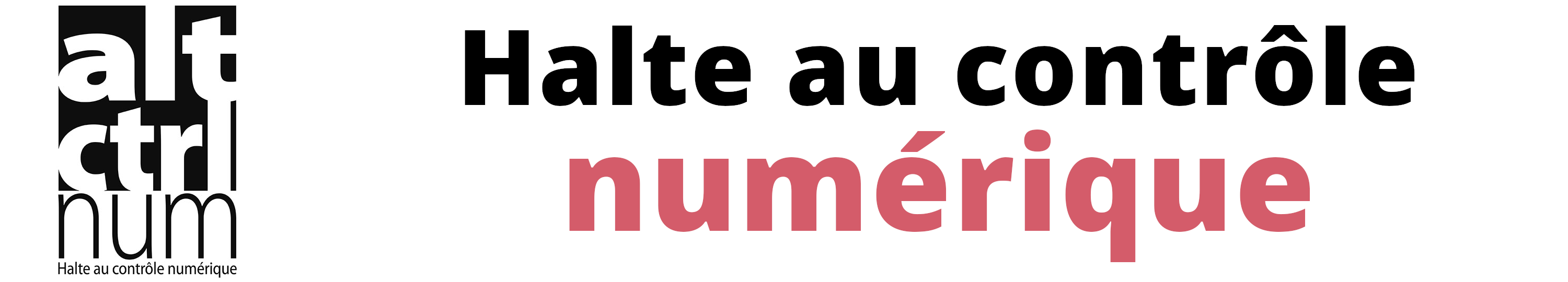© Photo illustration Sébastien Calvet / Mediapart
Article d'un sociologue belge, Daniel Zamora-Vargas, diffusé dans Le Monde diplomatique de juillet 2025.
Déclenchée après le vote pour le Brexit et l’élection de M. Donald Trump en 2016, la grande bataille des gouvernements libéraux contre les "fake news" part d’un présupposé : si les gens étaient correctement informés, ils voteraient bien, c’est-à-dire pour eux. Se pourrait-il, au contraire, que la contestation parfois délirante du discours dominant exprime une authentique aspiration populaire au changement ?
Quelques jours après l’inauguration du second mandat présidentiel de M. Donald Trump sous le regard bienveillant des oligarques de la Silicon Valley, le pape François alertait contre la "désinformation". "Trop souvent, notait alors le souverain pontife, la communication simplifie la réalité pour provoquer des réactions instinctives [1] ." Si l’on ne peut s’empêcher de sourire à l’idée que l’Église catholique — celle de l’Immaculée Conception, de la résurrection des morts et de la transformation de l’eau en vin — se place aux avant-postes du combat pour la vérité, ce diagnostic n’en est pas moins partagé par de larges franges du monde intellectuel et médiatique.
Depuis la victoire du Brexit au référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne en juin 2016, la prolifération de titres accrocheurs concernant les fake news et la "post-vérité" repose, à quelques variations près, sur un même récit : les algorithmes, qui valorisent la viralité, le clivage et les communautés de semblables, renforcent nos biais cognitifs et avantagent les fausses informations aux dépens des "faits". La sphère publique se serait ainsi fractionnée en d’innombrables "tribus" autoréférentielles nichées dans des médias compartimentés : les universitaires en résistance sur Bluesky, les néofascistes vociférant sur X.
À chaque sensibilité sa chaîne YouTube et ses comptes Instagram [2]. Dans cette configuration, la capacité d’argumenter, de s’écouter mutuellement et de résoudre des conflits par le biais de la raison laisserait peu à peu place à une guerre civile numérique nourrie par l’ambition politique de quelques milliardaires. Principale victime : la vérité elle-même. Ou, pour être plus précis, notre faculté à distinguer le vrai du faux.
Cette bascule aurait à son tour enfanté deux évolutions notables. La première a été bien décrite par le journaliste américain Matt Taibbi : non seulement la politique a "cessé de porter sur l’idéologie ; elle est devenue un problème d’information", mais "notre rapport aux faits est désormais similaire à notre rapport aux marchandises : il s’agit d’un marché des faits" [3].
Au sein de l’espace public, ce ne sont plus des idées qui se concurrencent, mais les faits eux-mêmes. Lesquels s’échangent à la hausse ou à la baisse en fonction de leur capacité à capter l’attention sur les plates-formes. Le marché aurait ainsi conquis la sphère publique : est vrai ce qui se vend le mieux.
Seconde transformation : en permettant l’accès des profanes au terrain de l’expertise professionnelle, les réseaux sociaux brisent un monopole jusqu’ici revendiqué par les grands médias. Face à une telle désintermédiation, les appels à la régulation se multiplient pour rétablir la hiérarchie du savoir et protéger les populations des mensonges.
Renverser l’explication habituelle
Si ces interprétations recèlent une part de vérité, elles n’en restent pas moins très insatisfaisantes. Tout d’abord, elles extrapolent largement les effets de la désinformation sur les dynamiques politiques contemporaines. Une attention extravagante a été donnée aux faux comptes russes lors de l’élection de M. Trump en 2016 ; on souligne cependant rarement que le contenu de ces comptes a représenté à peine 0,004 % de ce que les utilisateurs de Facebook ont vu sur leur fil durant cette campagne présidentielle [4].
Plus généralement, comme le note une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature à la veille de son second mandat, les contenus peu fiables correspondent à 5,9 % des visites sur des sites d’information en 2016. Mais, lorsqu’on inclut la télévision, ceux-ci ne comptent plus que pour "0,1 % du régime médiatique des citoyens américains" [5].
Enfin, une autre enquête publiée dans Science établit que la consultation de ces fausses informations concerne surtout un groupe restreint d’électeurs ayant déjà des opinions relativement extrêmes. Sur Twitter, 1 % des utilisateurs représentaient 80 % des expositions aux fake news [6]. Ils étaient donc moins souvent induits en erreur en tombant sur une information qu’ils ne recherchaient une information confirmant leur "erreur".
La majeure partie de la littérature sur la "désinformation" recèle en réalité un impensé : si les individus avaient reçu de "bonnes" informations, le Royaume-Uni serait toujours membre de l’Union européenne et les démocrates américains occuperaient encore la Maison Blanche. S’ils troquaient X pour le New York Times, l’histoire aurait pris un autre cours.
Cette littérature part ainsi du postulat qu’une personne bien informée ne pourrait pas désirer la sortie de l’Union ni le protectionnisme. En d’autres termes, toute remise en cause du cadre libéral aurait pour origine une méconnaissance des "faits". L’argument se heurte à deux objections. D’abord, il est peu probable que les partisans de candidats plus classiques soient davantage guidés par leur raison ; ensuite, on peine à expliquer le succès singulier de l’extrême droite en s’appuyant sur des modèles psychologiques.
Au lendemain de la première guerre mondiale, à laquelle il avait participé en tant que sergent d’infanterie, l’historien français Marc Bloch s’était penché sur la genèse et la diffusion des "fausses nouvelles" ayant nourri le conflit. "L’erreur ne se propage, ne s’amplifie, analyse alors le fondateur de l’école des Annales, qu’à une condition : trouver dans la société où elle se répand un bouillon de culture favorable. En elle, inconsciemment, les hommes expriment leurs préjugés, leurs haines, leurs craintes, toutes leurs émotions fortes." Il ajoute : "Un événement, une mauvaise perception par exemple qui n’irait pas dans le sens où penchent déjà les esprits de tous pourrait tout au plus former l’origine d’une erreur individuelle, mais pas d’une fausse nouvelle populaire et largement répandue" [7].
Cette perspective incite à renverser les termes de l’explication. Ce ne sont pas les algorithmes et nos biais cognitifs qui sapent la légitimité des institutions ; c’est dans le déclin de cette légitimité que prospèrent des aspirations plus radicales au changement. En outre, l’érosion de la confiance dans les démocraties libérales ne provoque pas un manque d’esprit critique. Tout au contraire : des fractions croissantes de la population estiment qu’elles ne peuvent plus accorder leur crédit aux scientifiques ou aux experts, et fondent dorénavant leurs jugements sur une recherche personnelle.
En un sens, les sceptiques à l’égard des vaccins ou les partisans de théories du complot sont davantage informés — mais pas nécessairement mieux — que les personnes confiantes dans les prescriptions de leur médecin ou dans le discours porté par les institutions. Si vous croyez que le 11-Septembre a été une machination organisée par l’administration Bush pour lancer une série de "guerres contre le terrorisme", vous avez probablement consacré énormément de temps à décortiquer documents et vidéos afin d’opérer votre propre tri entre le vrai et le faux.
Naturellement, sauf à devenir soi-même expert dans des domaines souvent très techniques, cette quête est vouée à l’échec. Notre rapport au savoir passe toujours par une délégation de confiance. En refusant de l’accorder aux spécialistes reconnus, les sceptiques orientent simplement leur confiance vers d’autres acteurs (influenceurs, blogueurs, etc., qu’ils jugent plus crédibles). Comme le résume le politiste Henrik Enroth, "la situation de post-vérité ne concerne pas un rejet des faits ou un déclin de la vérité en tant que telle", mais plutôt "une défiance généralisée et intensifiée" envers les autorités mandatées pour établir les connaissances.
À l’ère des fake news, on n’observe pas "un abandon de la recherche de preuves, mais leur quête pathologique" [8]. Le clivage pertinent ne départage donc pas les personnes pro et anti-vérité, mais une attitude "personnelle ou impersonnelle à l’égard des sources de preuve [9]". Dans une société de plus en plus désintermédiée, où les individus ne sont plus membres de partis politiques, de syndicats ou d’associations, notre attitude vis-à-vis de la "vérité" s’individualise elle aussi. Les algorithmes occupent le vide laissé par le déclin de l’encadrement politique et social des citoyens davantage qu’ils n’en sont la source.
Si des transformations sociologiques ont amplifié l’individualisation depuis les années 1980, les déceptions politiques à répétition y ont également contribué. Le sentiment d’absence de solution de rechange au libéralisme économique et d’impuissance de la sphère publique a accéléré la méfiance envers les élus et leur parole.
La prolifération d’experts médiatiques qui au tournant des années 2000 exposaient à jet continu leurs opinions comme une simple énonciation des faits, alors même qu’Internet ouvrait une brèche dans leur monopole, a participé au discrédit d’une certaine forme de régulation des discours. Il n’est pas nécessaire de se ranger du côté des "Covid-sceptiques" pour saisir que les normes sanitaires ne reposent pas uniquement sur des faits, mais aussi sur des considérations morales et des arbitrages entre libertés et droits : elles relèvent de la politique.
Lorsque ces choix se présentent comme des acquis de la science, le risque d’un rejet plus général du discours scientifique s’amplifie. S’il serait absurde et dangereux de récuser toute forme d’expertise, sa substitution à la politique pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.
C’est dans ce discrédit que naît la quête d’autres théories pour trouver un sens à la réalité. La concurrence n’oppose pas les "faits" et les fake news mais les différentes constructions intellectuelles disponibles pour en rendre compte. Le Brexit et l’élection de M. Trump renvoient moins à la crise de la vérité qu’à celle du libéralisme et de la technocratie : l’interprétation du monde qu’ils proposent ne correspond plus à l’expérience des individus.
Ainsi, les trois composantes centrales du néolibéralisme — marchandisation de sphères toujours plus étendues de la vie sociale, soustraction des décisions économiques au contrôle démocratique et libre circulation du travail et du capital — suscitent une hostilité croissante.
Depuis la crise économique de 2008, les deux pôles du spectre politique s’emploient à y faire pièce. La gauche insiste sur les inégalités et le déclin de la puissance publique, et avance une critique parfois emberlificotée de la mondialisation, le tout dans un ensemble sans grande cohérence, en particulier lorsqu’il s’agit de l’Union européenne. L’extrême droite ne remet pas en cause l’ordre économique mais fustige la mobilité du travail et prône la réaffirmation des valeurs familiales traditionnelles, de l’identité culturelle et des normes morales, perçues comme autant de remparts à une libéralisation des mœurs qui aurait miné notre "mode de vie".
Le retour de l’avenir
Dès lors, l’échec de la gauche tient moins aux algorithmes qu’aux obstacles colossaux inhérents à son projet : une transformation du régime économique se heurte à des contraintes autrement plus importantes qu’une politique identitaire.
L’une paraît hors de portée, l’autre se met aisément en scène par des mesures fortes en matière d’immigration. MM. Trump et Viktor Orbán ainsi que Mme Giorgia Meloni doivent leurs succès moins aux "faits alternatifs" qu’à leur théorie politique de substitution, capable d’ouvrir pour un large public la perspective d’un changement : un autre cadre, socialement toxique mais qui permet à des individus d’interpréter leur propre désarroi.
Comme l’a noté l’historien Adam Tooze, "comparé à la seule autre voie réellement existante aux États-Unis aujourd’hui, les démocrates", le trumpisme "est plus disposé à parler de l’avenir, et à le faire en des termes audacieux et éclatants" [10]. Une stratégie que M. Trump n’a pas hésité à présenter comme potentiellement austère dans un premier temps. Les Américains, expliquait-il le 30 avril dernier, devraient peut-être se résoudre à n’acheter que deux poupées à leurs enfants plutôt que trente, si c’était là le moyen de freiner l’importation de produits chinois.
Le président ne justifie pas son ambition de reconfigurer le système commercial mondial par des bénéfices économiques immédiats, mais par une vision politique de long terme destinée à garantir l’hégémonie de son pays. La victoire du projet porté par M. Trump ne saurait donc se réduire à l’effet d’algorithmes ou d’ingérences russes. Et face aux obstacles qui entravent une politique de gauche, bien plus considérables qu’un éventuel rationnement de poupées chinoises, l’appel aux "faits", à l’"expertise" ou à la "raison" risque de ne pas suffire.
Notes
[1] Pape François, Rome, 24 janvier 2025.
[2] Cf. Lee McIntyre, Post-Truth, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 2018 ; Jonathan Rauch, The Constitution of Knowledge : A Defense of Truth, Brookings Institution Press, Washington, DC, 2021.
[3] Sean Illing, "Matt Taibbi on Donald Trump’s strange appeal", Vox, 1er février 2017, www.vox.com
[4] Olivia Solon et Sabrina Siddiqui, "Russia-backed Facebook posts “reached 126 million Americans” during US election", The Guardian, Londres, 31 octobre 2017.
[5] Ceren Budak, Brendan Nyhan, David M. Rothschild, Emily Thorson et Duncan J. Watts, "Misunderstanding the harms of online misinformation", Nature, vol. 630, n° 8015, Londres, 6 juin 2024.
[6] Nir Grinberg, Kenneth Joseph, Lisa Friedland, Briony Swire-Thompson et David Lazer, "Fake news on Twitter during the 2016 U.S. presidential election", Science, vol. 363, n° 6425, 25 janvier 2019.
[7] Marc Bloch, "Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de la guerre", Allia, Paris, 2025 (1921).
[8] Henrik Enroth, "Crisis of authority : the truth of post-truth", International Journal of Politics, Culture, and Society, vol. 36, n° 2, juin 2023.
[9] Diana Popescu-Sarry, "Post-truth is misplaced distrust in testimony, not indifference to facts : implications for deliberative remedies", Political Studies, vol. 72, n° 4, Londres, novembre 2024.
[10] Adam Tooze, "Trump’s futurism : Elon’s rockets and fewer dolls for “baby girl”. Part I", Chartbook, 6 mai 2025.