Dans le blog de Médiapart "Géographies en mouvement", quatre universitaires européens mobilisent les apports de trois ouvrages pour analyser en quoi l'introduction du numérique dans l'école vise à la destruction de l'école publique, dans l'ensemble de l'Europe. C'est bien sûr la stratégie des industriels, mais aussi celle des Etats conduits pour la plupart par des adeptes de politiques libérales.
Par Manouk BORZAKIAN (Lausanne), Gilles FUMEY (Sorbonne Univ./CNRS). Renaud DUTERME (Arlon, Belgique), Nashidil ROUIAI (Université de Bordeaux)
Les études montrant les effets dramatiques des écrans sur le cerveau s’accumulent. Parallèlement, la numérisation à marche forcée de l’enseignement se poursuit. Avec "Bienvenue dans la machine"(Ecosociété), les philosophes Éric Martin et Sébastien Mussi apportent leur contribution à la critique du tout numérique, entre constat clinique et réflexion sur le sens de l’existence.
C’est un petit accroc dans la bien huilée démocratie helvétique. Au printemps dernier, le Conseil communal (assemblée consultative) de Lausanne découvrait qu’en matière de numérisation des écoles, la commune devait se plier aux décisions prises à l’échelle cantonale. Il faudra donc, pour près de onze millions de francs et malgré quelques (timides) oppositions, équiper les écoles de la ville en tableaux interactifs.
Un micro-événement, peut-être. Mais on pourrait multiplier les exemples de ces dépenses multimillionnaires dans le pays, comme ailleurs en Europe et en Amérique du Nord. Et constater le même consensus au sein de l’essentiel de la classe politique.
Les mesures austéritaires taillent continument dans la santé et l’éducation, mais l’argent coule à flots pour financer des installations numériques en tout genre de l’école maternelle à l’université: équipement des élèves en tablettes, informatisation des fronts de classe, dématérialisation des supports de cours, achat de licences pour des applications censées révolutionner l’enseignement… la liste évolue au rythme de l’inventivité des entreprises du secteur.
La religion de l'innovation
Les enquêtes documentant les dégâts du numérique sur la qualité de l’enseignement ne manquent pourtant pas. Éric Martin et Sébastien Mussi rappellent l’échec cuisant de l’enseignement à distance durant la pandémie de Covid-19: les cours en ligne ont causé des retards dans les apprentissages et généré une perte de motivation et d’investissement. À rebours des beaux discours sur une supposée meilleure prise en charge des élèves en difficulté, les plus vulnérables ont le plus pâti de la situation.

L’expérience des MOOC, ces cours en ligne censés démocratiser l’accès à toute sorte de savoirs, l’avait déjà montré. Passé l’enthousiasme – et les juteux profits – des débuts, il a bien fallu se rendre à l’évidence: avec des taux d’abandon stratosphériques, les MOOC ont tout au plus profité à quelques personnes déjà diplômées du supérieur. Plus largement, le psychiatre allemand Manfred Spitzer, avec d’autres, a dressé la liste des conséquences néfastes des écrans en contexte scolaire, en particulier sur les apprentissages fondamentaux comme la lecture et l’écriture. Au point que la Suède, pionnière en la matière, semble sur le point de faire machine arrière.

Comment expliquer le consensus accompagnant la numérisation à marche forcée de l’enseignement? Il y a, évidemment, une idéologie du "progrès" technologique bien ancrée dans les sociétés occidentales, posant l’évolution technique comme une nécessité, une norme dont la critique est inconcevable. Idéologie nourrie, Lewis Mumford le disait déjà en 1963 [1], par un "mythe de puissance illimitée" justifiant l’extension infinie de l’automatisation et de la mécanisation, "quel qu’en soit le coût ultime pour la vie".
Le business de l'éducation
Comme derrière toute idéologie, pas besoin de chercher loin pour déceler les profits matériels et symboliques que les principaux intéressés retirent de cette fuite en avant. Dans le cas français, on doit à Christophe Cailleaux une belle description des ramifications de la "EdTech". Celle-ci réunit les GAFAM et une myriade de start-up en tout genre, avec le soutien d’associations d’intérêt et de fonds d’investissement. Il faut ce qu’il faut. Les autorités publiques ne sont pas en reste: du ministère de l’éducation au moindre collège, mis en concurrence avec ses pairs dans la course aux financements, les initiatives visant à relever le défi de la numérisation du monde assurent, par une heureuse coïncidence, "un transfert massif de fonds publics vers le privé [2]".
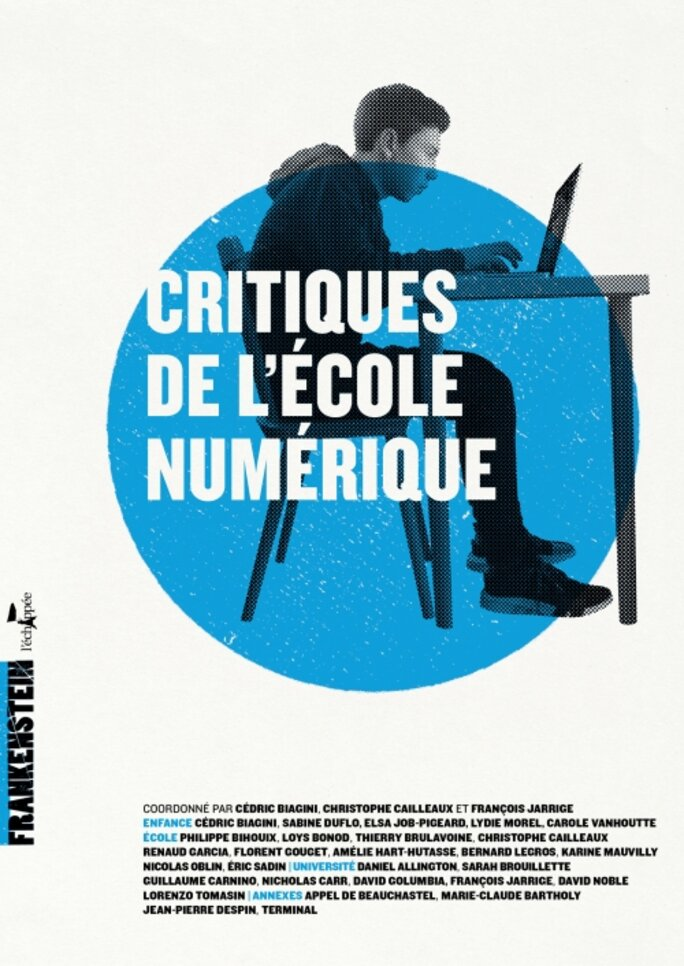
Convaincre le plus possible de responsables politiques et d’établissements scolaires de la nécessité d’innover sans cesse est donc avant tout le meilleur moyen de stimuler l’essor d’un marché de l’éducation pesant des milliards. Milliards qui ne manqueront pas de se reproduire dès lors, rappellent Éric Martin et Sébastien Mussi, que le numérique apporte son lot de problèmes, auxquels il ne manquera pas d’apporter lui-même des solutions. Par exemple les logiciels de détection de plagiat, ou encore les intelligences artificielles permettant de garantir qu’un texte n’a pas été généré… par une intelligence artificielle. À l’arrivée, entre le renouvellement régulier du parc informatique, celui des licences – pas question d’utiliser des logiciels libres – ou encore les coûts liés au stockage ou à la sécurité des données, on atteint des budgets millionnaires à l’échelle des établissements.
Le tableau ne serait pas complet sans évoquer les «experts» écumant les plateaux de télévision entre deux rapports ministériels. L’historien Thomas Le Roux raconte [3] comment, au tournant des 18e et 19e siècles, un travail de légitimation des pollutions a accompagné l’industrialisation de Paris. Des armées de médecins et de chimistes ont mêlé leur légitimité scientifique et leur mauvaise foi pour assurer l’opinion publique de l’innocuité des émanations chimiques en provenance des usines, allant jusqu’à louer leurs bienfaits pour le système respiratoire. Aujourd’hui, neurologues, pédagogues et "chercheurs indépendants" en tout genre se bousculent pour lancer des anathèmes contre les "technophobes" et autres "luddites", en prenant soin d’ignorer leurs arguments.
Détruire l'éducation (publique)
Car, tel Michel Serres en extase devant sa «Petite Poucette» et enfilant les perles sur les merveilles d’internet comme outil éducatif, défendre la numérisation de l’école, c’est être dans le coup. Comme Edison prédisant le bouleversement de l’éducation par le cinéma au début du 20e siècle – finalement non – ou d’autres annonçant une non moins grande révolution à l’école grâce à la télévision – toujours pas – internet doit permettre, selon la doxa, d’enterrer l’éducation à la papa. Finie la relation verticale enseignant-élève, adieu le bête et méchant par-cœur, terminées les règles de grammaire incompréhensibles et inutiles, au rebut les cours magistraux, place à l’éducation du 21e siècle connectée, bienveillante, individualisée et disruptive. Un peu de démagogie, un soupçon de libertarisme cool, une touche de novlangue entrepreneuriale, et voilà l’institution scolaire renvoyée à son image poussiéreuse et sclérosée.
En réalité, la numérisation de l’enseignement permet l’escamotage d’enjeux cruciaux: inégalités scolaires, locaux délabrés, manque de personnel enseignant mais aussi administratif et technique… Discuter sans fin des méthodes d’enseignement et d’outils censément révolutionnaires permet aussi de mettre sous le tapis la question des objectifs pédagogiques: qu’apprend-on à l’école, et pourquoi? Au lieu d’une éducation à l’esprit critique, la numérisation participe à transformer l’enseignement en une entreprise standardisée d’adaptation des élèves-clients aux évolutions du marché du travail et, plus largement, au règne de la raison marchande.
Derrière la volonté affichée – et par ailleurs défendable, si elle n’était pas dévoyée – de faire descendre l’enseignant de son piédestal et de repenser les méthodes d’apprentissage, la numérisation de l’enseignement vise la réduction de l’enseignant à un rôle d’"opérateur de la machine qui vise à le remplacer", écrivent Éric Martin et Sébastien Mussi. Elle permettra, à terme, le recrutement de quelques intermédiaires sans expertise, en lieu et place d’un corps enseignant coûteux – et, quoique de moins en moins, parfois revendicatif. Elle avance main dans la main avec les discours de promotion des "pédagogies alternatives", soigneusement vidées de leurs principes émancipateurs d’origine et désormais destinées à servir de "produit d’appel pour une nouvelle offre d’enseignement privé", comme le résume Laurence De Cock.
La vie dans Wall-E
Mais quand bien même le numérique ne serait pas le cheval de Troie de celles et ceux qui confondent émancipation humaine et marchandisation, progrès humain et délire technologique, faudrait-il se réjouir ? Éric Martin et Sébastien Mussi attirent l’attention sur les enjeux de la coprésence: être ensemble dans une classe, sans la médiation des écrans, de leurs sources infinies de distraction et de leur obésité informationnelle, c’est faire l’indispensable expérience de l’autre, avec les difficultés et les tensions inhérentes à la vie en société. C’est cultiver sa capacité d’écoute, y compris de ce qui dérange chez une personne ou dans un texte, en lieu et place du réflexe consistant à zapper ou à couper dès que quelque chose nous déplaît, à se réfugier derrière un écran permettant de s’affranchir des frottements du réel. C’est, pour reprendre la formule d’un autre philosophe, Renaud Garcia, refuser "l’obsolescence de la relation [4]".

Wall-E, réal. Andrew Stanton, 2008 – © Pixar Animation Studios
En 2008, dans le dessin animé Wall-E, les coscénaristes Andrew Stanton et Jim Reardon imaginaient les restants de l’humanité, réfugiés sur une base spatiale, menant une vie entièrement connectée et réglée par des algorithmes. Une foule d’individus avachis sur des fauteuils mobiles suivant un itinéraire programmé, s’alimentant en sirotant à heures fixes des sodas, rivés la totalité du temps sur des écrans personnels et, par conséquent, n’interagissant jamais avec leurs semblables, présents mais absents. Quelques minutes dans une salle de classe permettent de se convaincre que ce monde n’est pas très loin de nous. Un monde peu désirable qui – pour citer une dernière fois Éric Martin et Sébastien Mussi – "remplace la société par les réseaux informatiques et la politique par les systèmes autonomisés".
[1] Technique autoritaire et technique démocratique, La Lenteur, 2021 (réédition reprenant le discours prononcé par Lewis Mumford en 1963).
[2] Christophe Cailleaux, La ed tech à l’assaut de l’éducation, dans Critiques de l’école numérique, L’Échappée, 2019.
[3] Le Laboratoire des pollutions industrielles, Albin Michel, 2011.
[4] La chair de l’enseignement. Fragments sur l’obsolescence de la relation, dans Critiques de l’école numérique, L’Échappée, 2019.
À lire
Éric Martin & Sébastien Mussi, Bienvenue dans la machine. Enseigner à l’heure du numérique, Écosociété, 2023.
Cédric Biagini, Christophe Cailleaux, François Jarrige (dir.), Critiques de l’école numérique, L’Échappée, 2019.
Laurence De Cock, Les pédagogies alternatives sauveront-elles l’école ?, Le Monde diplomatique, septembre 2023.
Lewis Mumford, Technique autoritaire et technique démocratique, (trad. de l’anglais par Annie Gouilleux), La Lenteur, 2021.
Manfred Spitzer, Les Ravages des écrans. Les pathologies à l’ère numérique, (trad. de l’allemand par Frédéric Jolly), L’Échappée, 2019.
Le numérique éducatif, ça ne marche pas !, sur le site du Café pédagogique
Sur le blog
Les vies brisées du numérique, Renaud Duterme
Pour nous suivre


3 réponses sur « Le numérique, outil de destruction de l’enseignement public ? »
[…] Le numérique, outil de destruction de l’enseignement public ? […]
[…] Le numérique, outil de destruction de l’enseignement public ? […]
[…] Le numérique, outil de destruction de l’enseignement public ? (11/2023) […]